13
juin
2007
Après un billet déjà ancien riche en données quantitatives, étudions ce que la sociologie et l'étude micro des pratiques nous apprend sur la collaboration en science, et en particulier sur la signature des articles scientifiques. Avec la communauté des physiciens comme modèle[1]
En physique à la différence de la recherche biomédicale, il est considéré normal de voir des listes d'auteurs assez longues pour certains articles, notamment en physique des hautes énergies. Alors qu'en médecine des propositions éditoriales et l'éthique ont tenté de mettre de l'ordre dans ces pratiques, la physique n'y voit pas matière à discussion. L'hyper-cosignature (hyperauthorship) ne facilite pourtant pas l'évaluation de la contribution de chaque auteur ” base du système de récompense à la Merton (reward) au sein de la communauté scientifique. Comment expliquer cette apparente contradiction ?
En fait, signer un article scientifique a trois rôles :
- s'attribuer le crédit d'une découverte (pourtant, les expériences sur les accélérateurs de particules sollicitent parfois 2000 chercheurs, ingénieurs et techniciens mais seule une petite équipe de chercheurs conduit l'analyse aboutissant à un article : qui créditer ?),
- en reconnaître la paternité (et tout ce qui va avec : la responsabilité en cas de fraude, la propriété intellectuelle en cas de brevet etc.)
- permettre l'accroissement de sa réputation ou "capital symbolique" (qui est le moteur du champ scientifique, et explique certaines co-signatures de complaisance).
A la suite de 32 entretiens menés auprès de chercheurs, ingénieurs et responsables des expériences de LHC au CERN, Birnholtz a constaté que les physiciens sont bien conscients de ces enjeux et ont quelques stratégies pour les aborder. En ce qui concerne le crédit, des formulaires visés par la hiérarchie permettent de trouver un consensus sur les auteurs à faire figurer sur chaque article, listés dans l'ordre amphabétique. Et aucune publication n'est permise sans qu'elle soit validée par la hiérarchie ” interdiction donc de publier dans son coin en s'attribuant tout le crédit d'un travail collectif. Les chercheurs sont également bien conscients que sur des projets qui s'étendent sur des décennies et demandent énormément de travail en amont, les ingénieurs décédés comme les techniciens de l'ombre sont aussi importants que le jeune post-doc qui a réalisé l'analyse des résultats.
La paternité en découle, bien qu'elle soit parfois sujette à conflit : les chercheurs font souvent référence à l'histoire de Carlo Rubbia, qui a obtenu le prix Nobel de physique en 1984 pour la direction d'un travail collectif au CERN, récompense qui n'a été permise que par le travail d'environ 200 personnes. Certains chercheurs sont aussi prudents à l'excès, préférant retirer leur nom qu'endosser la responsabilité d'un article qu'ils n'ont pas lu ou ne se sentent pas capable d'expliquer en public.
Concernant la réputation, elle est extrêmement important face à la misère des postes offerts, mais se juge presque plus d'après le bouche à oreille que le CV ” certains chercheurs reconnaissent en effet qu'il n'ont lu que très peu des 200 articles figurant sur leur CV ! D'où l'importance de la réputation informelle, celle acquise par le ouï-dire mais aussi lors des réunions d'équipe, des séminaires, des colloques etc. Ou encore, évidemment, en se mettant en position de meneur
Mais ce système très encadré par la hiérarchie et sans possibilité de recours formel fait des malheureux. Ce sont surtout les femmes (représentant seulement 10 % du personnel du CERN) ou les chercheurs non-permanents qui estiment ne pas avoir la reconnaissance qu'ils mériteraient. Il est dur d'être parfaitement juste à cette échelle, là où Merton voyait pourtant un système démocratique idéal[2] !
En fait, selon Birnholtz, il faudrait distinguer (notamment dans les publications) entre deux niveaux d'auteurs : le niveau "infrastructural", lié à la conception des détecteurs et logiciels, récurrent dans la série d'articles issus d'un même appareillage ; et le niveau "découverte" différent pour chaque article, revendiqué par les auteurs qui peuvent défendre leurs résultats au niveau le plus fin.
Notes
[1] Jeremy P. Birnholtz (2006), "What does it mean to be an author? The intersection of credit, contribution, and collaboration in science", Journal of the American Society for Information Science and Technology, 13(57): 1758-1770 (preprint)
[2] Robert K. Merton (1942), "A note on Science and Democracy"

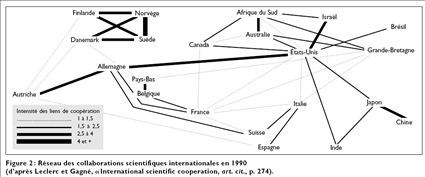

Derniers commentaires